
Charlie and The Fizzy Factory
Les bonbons pétillants
A. Le ressentit du gout
Quand on mange un bonbon, le goût de celui-ci nous plaît, c’est pour cela qu’on ne peut pas éviter d’en manger. Mais comment percevons-nous le goût des bonbons ?
Le goût, est en effet, le sens qui nous permet de percevoir les différentes saveurs. Cette perception sera souvent liée à une identification du mélange de substances chimiques, donc d’aliments. Pendant la dégustation, plusieurs sensation sont recueillies, et de nombreux facteurs y joue un rôle important. Le rôle le plus important se joue dans la cavité buccale, grâce à la stimulation des papilles gustatives. Mais aussi l’odorat, joue un rôle sur le goût. Il permet de différencier les arômes des aliments. Ceci fait que lors de la dégustation, nous sommes aussi sensibles aux odeurs, comme nous le serons aussi à d’autres sensations gustatives. On fait la différence entre l’arôme d’un aliment et son odeur. L’arôme est l’odeur que dégagent les aliments lors de la mastication ; les particules odorantes libérés dans la bouche. De plus, l’arôme et l’odeur sont différentes car les particules odorantes subissent dans la bouche des réactions chimiques avec la salive, la chaleur… Ainsi de nouvelles arômes se libèrent.
Tout d’abord, c’est l’olfaction ortho-nasales qui entre en jeu. C’est l’olfaction de l’odeur des aliments qui sont portés à la bouche. Ensuite, pendant la mastication, cette odeur va subir des réactions chimiques avec la salive, la chaleur… qui vont faire libérer, de l’aliment, de nouvelles particules odorantes. Celles-ci formeront enfin l’arôme. On fait donc la différence entre l’arôme d’un aliment et son odeur, car ils ne sont pas formés des même particules odorantes, donc ne vont pas avoir le même parfum. L’arôme, donc les particules odorantes, vont ensuite se diriger vers la partie arrière de la gorge, pour rejoindre la cavité nasale, où se trouvent les récepteurs olfactifs. La stimulation de ces récepteurs est l’olfaction retro-nasale.
Schéma de l'Olfaction Orthonasale et Retronasale
La preuve que l’olfaction joue un grand rôle dans le goût, est que pour certaines personnes, lors d’un rhume, ils sont incapables, ou presque, de déguster les aliments. Cela est dût par le fait que les particules odorantes sont incapables de rejoindre les récepteurs olfactifs, à cause du mucus cumulé dans la cavité nasale. Donc l’olfaction retro-nasale ne se produit pas. Enfin, selon le neurophysiologiste Patrick Mac Leod, le goût c'est « 95% d'olfaction et 5% de gustation ».
D’autre part, la détermination du goût se fait aussi grâce aux détecteurs gustatifs, cette fois-ci répartis dans toute la bouche, mais surtout sur la langue. Tout d’abord, la stimulation de ces détecteurs, se fait grâce aux molécules sapides. Ces molécules sont libérées par les aliments lors de la mastication, au contacte de la salive. (Les molécules sapides sont toujours solubles à l’eau). Il y a donc autant de saveurs que de molécules sapides. Les récepteurs de molécules sapides, sont appelés les papilles gustatives. Il y a quatre types de papilles, chacune ayant une fonction, et emplacement précis. Elles ressemblent à des petites granulosités qui donnent à la langue son aspect rugueux. Les quartes types de papilles gustatives, sont en faite recouvertes par l’épithélium lingual. C’est dans cette fine couche que se trouvent les bourgeons gustatifs. Il a aussi une fonction d’absorption et filtration mais aussi de conducteur pour les molécules sapides.
Les papilles les plus nombreuses sont les papilles filiformes. Celles-ci se trouvent au centre de la langue. Ce sont les papilles de plus haute taille, et elles ont une forme triangulaire. Elles sont les seules à ne pas avoir de bourgeons gustatifs, et vont donc être responsables des sensations tactiles, du ressenti de la température et de la consistance des aliments. Elles vont, de plus, former une surface similaire à celle d’une éponge pour retenir la salive. Ensuite, les papilles fongiformes, se trouvent sur la partie antérieur, sur la pointe et les cotés de la langue. Elles vont avoir le rôle de reconnaître aussitôt l’aliment mis dans la bouche, grâce aux bourgeons qu’elles contiennent, souvent entre un et cinq. Celles-ci auront la forme d’un champignon rosâtre, et seront les plus visibles des papilles. Puis, à l’arrière de la langue, l’on trouve les papilles caliciformes. Ce sont les papilles de plus grande taille, et celles qui contiennent le plus grand nombres de bourgeons, plusieurs centaines. Regroupées, elles ont la forme d’une V pointant vers la gorge, et vont se charger de la perception de tous les goûts, sans exceptions. Finalement, les papilles foliées, qui s'occupent aussi de la perception du goût, se trouvent en groupe à l’arrière de la langue, plutôt sur les bords, en formant de petites tranchées.
Schéma des papilles gustatives
Quant aux bourgeons, se sont des cellules microscopiques qui se situent dans les papilles gustatives, mais que l’on trouve aussi à l’intérieur des joues, des gencives, ou encore sur le voile du palais. Dans les papilles, le nombre total de bourgeons est d’environ 10 000. Ceux-ci sont organisés en rangs plutôt serrés et ont une structure semblable à celle d’un oignon. Ils possèdent sur leur extrémité un pore, appelé pore gustatif, qui fera une ouverture à sa surface de l’épithélium lingual (Tissu composé de cellules juxtaposées disposées en une ou plusieurs couches formant un revêtement, dans ce cas interne). De plus, les bourgeons sont constitués essentiellement de cellules gustatives, entre 50 et 125 par bourgeons. Ces cellules ont de fines projections, appelées les microvillosités, qui s'étendent jusqu’à l’épithélium lingual de la papille.
À la surface, les microvillosités capteront les molécules sapides dissoutes dans la salive. Chacune des cellules gustatives peut capter plusieurs dizaines de molécules sapides distinctes, parce qu’elles ne sont pas spécialisées dans la perception d’une seule saveur. Par exemple, le goût amer et le goût sucré peuvent être perçus par le même récepteur, mais vont donner une sensation très différente. Elles sont donc capables de détecter les molécules sapides en s’excitant, se stimulant, et finalement en libérant une information chimique.
Schéma des bourgeons gustatifs




B. Le ressentit du pétillement
Sur nos bonbons Peta Zetas, nous percevons le goût mais aussi le pétillement, ce qui est l’intérêt de manger ces bonbons, car cet effet nous plaît. Alors, comment percevons-nous le pétillement de ces bonbons?
Lorsque l’on parle du goût, on ne pense jamais à l’ensemble des sensations qui nous permettent d’identifier les aliments. La texture, le croquant, la température... Sont aussi d’autres paramètres qui participent à l’appréciation d’un aliment.
Ce sera grâce aux cellules sensorielles, situées dans toute la bouche et la gorge, que l’on recevra les sensations telles que la température de l’aliment, l’effet tactile... Leur mission est de créer un message chimique-somesthésique qui communiquera toutes les caractéristiques sensorielles non gustatives des aliments. Il existe plusieurs types de cellules sensorielles présentes dans la bouche, dont les papilles filiformes. Comme nous l’avons déjà commenté, ces papilles sont responsables des sensations tactiles, car contrairement aux autres types de papilles, elles ne contiennent pas de bourgeons. Elles ne vont donc pas avoir un rôle direct sur le goût, mais vont permettre de compléter le message gustatif. Ces papilles filiformes sont formées d’une surélévation de l’épithélium lingual. C’est donc dans l’épithélium de ces papilles filiformes que se trouvent les récepteurs tactiles.
Ensuite, le message chimique-somesthésique crée par ces récepteurs lors de la traduction de la stimulation sera directement transmis au cerveau par le nerf lingual. Ce nerf est une des trois ramifications du nerf trijumeau. Enfin, les messages se dirigeront vers le thalamus.
Les trois ramifications du nerf trijumeau
Le pétillement de nos bonbons va donc être capté par les papilles filiformes, pareil que pour le gaz des boissons gazeuses. Ainsi, le pétillement va être transmit par le nerf trijumeau dans le cerveau jusqu’à thalamus.
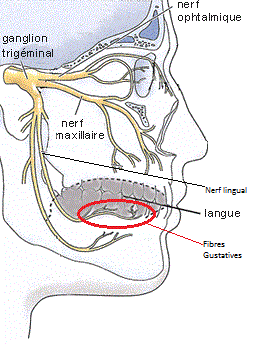
C. Vers le cerveau
Le nerf trijumeau ne transmet que l’information qui vient des cellules sensorielle, mais le goût vient des cellules gustatives. Alors, comment l’on peut reconnaitre le goût du bonbon, et le lier à la sensation de pétillement ?
Tous nos sens conditionnent les goûts que nous percevons et envoient au cerveau pleins de messages destinés à nous faire reconnaître ce qui est bon ou pas.
Tout d’abord, ce sont les microvillosités des cellules réceptrices qui vont conduire les molécules sapides jusqu’aux récepteurs gustatifs. Ces récepteurs ont pour rôle de détecter puis de capter les molécules sapides. Quand les molécules se lient aux récepteurs, ceux ci réagissent et créent une stimulation. Cette stimulation va parcourir la cellule réceptrice dans laquelle se trouve le récepteur, puis elle émettra un signal. Ce signal est donc le message gustatif. Celui-ci sortira du bourgeon par transmission dans les fibres des nerfs gustatifs. Il arrivera enfin au système nerveux central.
Ensuite, se sera le cerveau qui traduira le message gustatif en sensations gustatives, en évaluant et associant toutes les informations recueillies (aussi par le nerf trijumeau), pour créer la première image sensorielle globale.
Par la suite, cette image va se doubler pour prendre deux chemins différents. Tout d'abord, une image sera envoyée vers le système limbique. Ici, les informations vont prendre une connotation plutôt émotionnelle. Après, l’image passera par l’hypothalamus. Celle-ci est la zone cérébrale qui donne le plaisir inconscient, avant que l’information soit mémorisée, puis reconnue et comparée avec les données déjà enregistrées dans notre mémoire. Celle-ci est la fonction de l’hippocampe. L’autre direction que prend l’image est vers le thalamus. Ici l’image se complète avec les sensations de l’odorat et du toucher de la langue (information du nerf trijumeaux et du nerf olfactif). Ce sera la circonvolution post-centrale, près du cortex, qui s’occupera d’analyser et projeter l’image au cortex pour que nous reconnaissions l’aliment.
Schéma coupe du cerveau, trajet de l'image sensorielle
Mais alors, comment peut-on faire pour que notre bonbon donne du plaisir ?
Le plaisir est lié au système de récompense cérébrale. Quand le cerveau reçoit une récompense, plusieurs régions du cerveau, avec chaque une son rôle, et reliées entre elles, se stimulent et mettent en marche pour faire que l’individu ait du plaisir. Par exemple, la région du mésencéphale ou l’ATV (région de la partie moyenne du système nerveux du crâne, l’encéphale. Aussi appelé l'aire tegmentale ventrale (ATV), subit une augmentation dans son niveau d’activité. Lors du plaisir, cette région augmente la synthétisation de la dopamine,(elle favorise l’envie et le désir) puis le dirige dans le noyau accubens, mais aussi dans septum, dans l’amygdale puis dans le cortex préfrontale. Toutes régions cérébrales sont reliées par le faisceau de la récompense ou du plaisir (MFB) (les neuro-anatomique l’appel aussi « medial forebrain bundle » d’où MFB) et vont être les plus importantes dans la synthèse de récompense. De plus, le faisceau est principalement constitué du système dopaminergique mésocorticolibique, qui lui, est important pour nos motivations envers des comportements, de joie, de plaisir...
Ou encore, l’amygdale, qui est une des trois structures qui participent dans l’activation du plaisir, est connectée à plusieurs régions importantes qui vont affecter surtout les souvenirs, les émotions et le plaisir. Comme l'hippocampe. Celui-ci est impliqué dans la remémoration de souvenirs comme l’excitation ou la peur. L’amygdale peut donc provoquer une émotion déclenchée par un souvenir particulier. Ou encore le cortex préfrontal, qui est impliqué au processus d'extinction par un souvenir de peur devant une action soudaine. Mais dans le système de récompense, c’est le noyau accubens qui détient le rôle le plus important. Il est composé de deux types de neurotransmetteurs. D’une part la dopamine et de l’autre, la sérotonine, qui fais un effet de satisfaction. Enfin, le locus coeruleus, est plein de noradrénaline, et a un rôle important dans la toxicomane. Le locus se stimule lorsqu’il est dans une situation de manque, et va faire que l’individu désespère pour sa dose.
Le plaisir va donc être provoqué par la stimulation des régions dans le cerveau connectées entre elles qui fournissent une motivation sur nos comportements. Les regions activées pour la récompense cérébrale, peuvent être detectées grâce à un IRM.

